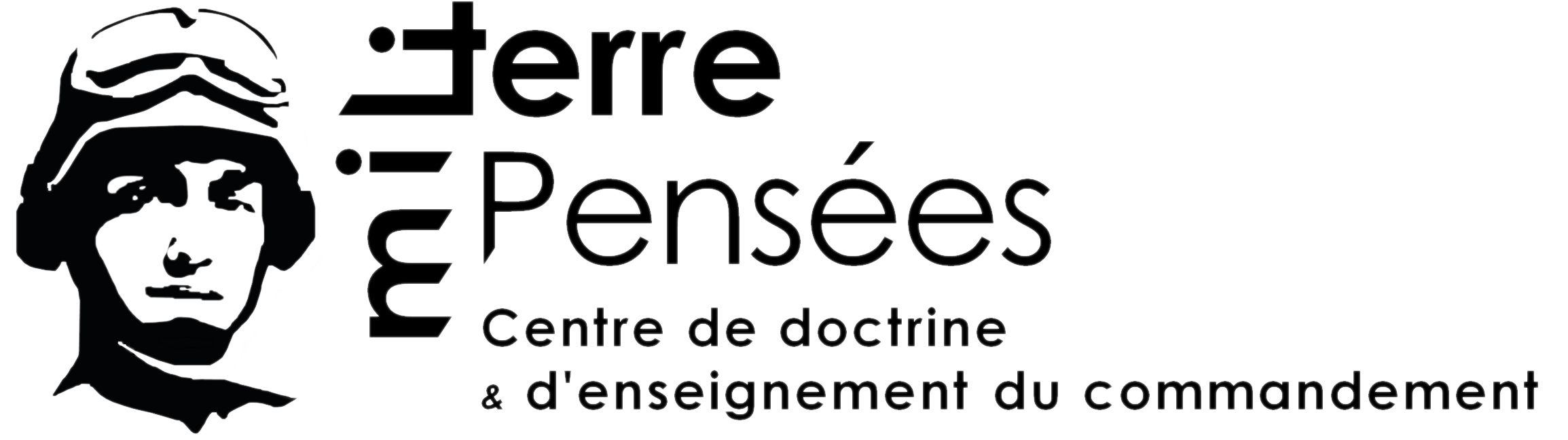Les articles à la une
⚡️ Enseigner l'esprit guerrier à un futur chef en opérationPublié le 22/12/2018
Cette citation, que l’on prête volontiers au maréchal Leclerc, illustre ce que pourrait représenter l’esprit guerrier pour un chef en opération, à savoir la volonté de vaincre, même lorsque tout semble perdu, la capacité à renverser une situation, à reprendre l’initiative au combat pour finalement l’emporter sur l’adversaire. Pour cela, être un simple meneur d’hommes ne suffit pas. Le chef doit également disposer de la capacité à prendre des décisions opérationnelles pertinentes, y compris dans les circonstances les plus défavorables. Savoir conserver ses moyens, sa faculté de discernement, résister à la pression, que celle-ci soit exercée par l’ennemi, par ses supérieurs, voire parfois même par ses subordonnés : telles sont les qualités requises pour un chef en opération. Il n’y a rien de pire au combat que la paralysie, l’indécision, voire le renoncement. Comment peut-on dès lors enseigner concrètement cette capacité à décider en opération ?
L’évolution technologique des transmissions au profit des liaisons de commandement dans les opérations terrestres depuis la PremPublié le 21/12/2018
Cette étude, basée sur des exemples historiques, visera à décrire l’évolution des moyens de transmissions au profit du commandement militaire en opération.
⚡️ Alain Mimoun, être le meilleur pour servir la FrancePublié le 21/12/2018
Le nom d’Alain Mimoun a durablement marqué le paysage sportif français – en attestent la centaine de stades, rues, avenues ou places à travers le pays, qui portent son nom. Trois fois médaillé olympique sur cinq mille et dix mille mètres en 1948 et 1952, double médaillé d’or aux Jeux méditerranéens en 1951 et 1955 avant de remporter l’épreuve du marathon à Melbourne en 1956, il a également été élu « athlète français du siècle » par les lecteurs de la revue Athlétisme en 1999. Le destin exceptionnel d’Alain Mimoun ne s’arrête pourtant pas à son parcours sportif. Détenteur de la Croix de Guerre 1939-1945, il a été décoré de la Légion d’honneur par quatre présidents et est notamment devenu le premier français d’origine nord-africaine Commandeur de la Légion d’honneur. Pour son amour de la France,« la plus belle fille au monde »1, Alain Mimoun a versé son sang et sa sueur ; un engagement qui aurait poussé Georges Marchais à lui déclarer :
« Mimoun, (…) vous êtes la France ! »2. Pourtant, rien ne semblait prédestiner ce natif d’Algérie, issu d’une famille modeste du Télagh, à un tel destin au service de la France. Cette admirable trajectoire semble ainsi avoir été particulièrement marquée par deux thématiques : celles de l’intégration à la Nation et de l’esprit guerrier.
Le sens de l'équitéPublié le 21/12/2018
L’ÉQUITÉ … QUOI ?
L’équité est un des fondements de la légitimité du chef. Exigence première de l’exercice du commandement,elle peut être définie comme la vertu qui consiste à régler sa conduite avec impartialité, dans un souci naturel et permanent de justice. Cependant, dans un monde marqué par une forte tendance aux revendications, l’équité ne doit pas être confondue avec l’égalitarisme. Reposant sur la juste appréciation, elle va bien au-delà de la stricte application de règles : c’est donc le chef qui garantit l’équité et non le règlement, étant entendu qu’il n’y a pas d’équité absolue.
Dans la pratique, l’équité nécessite une grande attention aux autres et une connaissance précise de l’environnement de ses subordonnés, de leurs contraintes et de leurs capacités. Elle conduit celui qui commande à trancher, à s’engager personnellement et à assumer ses choix.
L’emploi des réserves dans l’armée de Terre depuis 1947Publié le 20/12/2018
L’opération Sentinelle, qui voit le déploiement de plusieurs milliers soldats sur le territoire national, a mis en exergue le rôle des réservistes, tant dans leur fonction de complément capacitaire que dans celui de lien entre l’armée et la nation.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’emploi qui est fait des réservistes de l’armée de Terre, et leur acceptation idéologique, est intimement lié à l’évolution de la conjoncture politique, économique et sociale française. Depuis quelques années, il l’est encore plus à celle de la situation sécuritaire.
Cependant, de nombreux défis de toute nature subsistent pour équiper et maintenir l’attractivité de la réserve. C’est ce que les auteurs montrent dans cet article, en faisant également appel à l’exemple de nos voisins allemands et espagnols.
⚡️ Lanrezac et l’esprit guerrierPublié le 20/12/2018
L'armée de Terre redécouvre le général Lanrezac et c’est heureux. À la faveur de l’enseignement tactique du généralYakovleff à l’École militaire et d’un certain nombre de publications mémorielles à l’occa sion du centenaire de la Première Guerre mondiale, ce personnage à la personnalité et au parcours stupéfiants, a refait surface dans l’univers intellectuel français.
La participation de la France à la mise sur pied des forces terrestres étrangères depuis la décolonisationPublié le 19/12/2018
Les modifications récentes du dispositif des forces prépositionnées, principalement en Afrique, et les évolutions de la menace, appellent à s’interroger sur les évolutions et l’adéquation - ou non - de la participation française à la mise sur pied des forces terrestres de ce continent. Malgré une réduction de format et une concurrence accrue, internationale comme privée, la France demeure structurellement un partenaire privilégié de ce type d’actions grâce à une légitimité reconnue et une adaptation permanente de sa posture aux enjeux sub-continentaux.
⚡️ Esprit guerrier et "culture de guerre" pendant la Première Guerre mondialePublié le 19/12/2018
Le CDEC a reçu le 18 septembre 2018, le Professeur Stéphane Audoin-Rouzeau dans le cadre d’une discussion sur l’esprit guerrier et la « culture de guerre » en 1914-1918. Stéphane Audoin-Rouzeau est historien, chercheur à l’EHESS et président du Centre international de recherche de l’Histoire de la Grande Guerre de Péronne. Il a effectué sa thèse sur la presse des tranchées lors de la Première Guerre mondiale.
La disponibilitéPublié le 19/12/2018
LA DISPONIBILITÉ … QUOI ?
La disponibilité est une obligation statutaire pour tout militaire, qui va à l’encontre des usages de la société moderne (réduction du temps de travail, rétribution horaire). Ce principe peut d’ailleurs être écorné par une vie de quartier trop réglée (horaires quotidien, quartier libre le vendredi après-midi), que le chef veillera à adapter en fonction des besoins opérationnels et des impératifs de service. Pour le chef, elle est comme un impératif qui le place au service des autres et de son unité, faisant écho à la citation de Jean Guitton : « toute autorité est un service ». La disponibilité s’exprime à la fois dans les dimensions physique et intellectuelle. Pour le chef militaire, elle peut aussi être vue comme la première marque de son engagement et de son implication en tant qu’autorité, car le commandement doit d’abord s’incarner par la présence. Marque de désintéressement et d’investissement personnel, la disponibilité rend l’obéissance et l’adhésion plus spontanées. Elle entretient la confiance et prépare à l’engagement opérationnel.
Les nouvelles conditions des opérationsPublié le 18/12/2018
L’état classique de guerre ou de paix a cédé la place à une situation latente de crise dans laquelle les nations et les peuples subissent des tensions qui peuvent dégénérer en conflits armés. Sur un même théâtre d’opérations, les affrontements et les actions en faveur de la paix peuvent cohabiter. Les forces terrestres constituent aujourd’hui l’instrument principal par lequel une nation ou une coalition peut imposer sa volonté. Par leur contact permanent avec les différents protagonistes, elles jouent un rôle déterminant grâce à leurs capacités à symboliser un engagement politique, contraindre un adversaire, contrôler le milieu et influencer les perceptions.