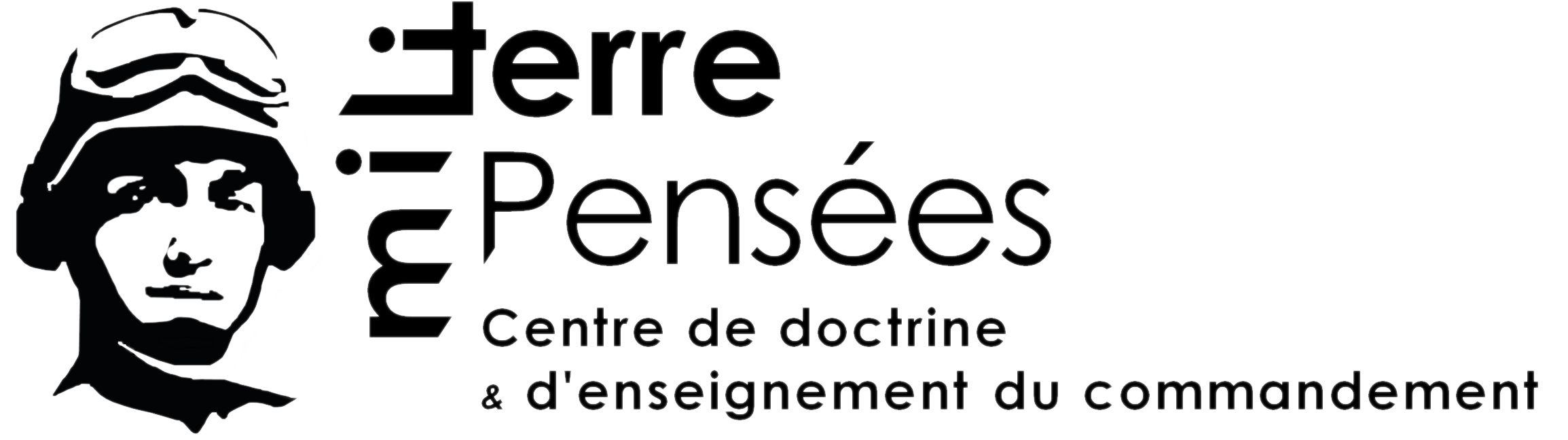Les publications associatives à la une
la cyberdéfense Publié le 21/08/2018
Une succession logique de 0 et de 1 au sein d’un code informatique binaire pourra-t-elle demain provoquer autant de dégâts qu’un missile de croisière naval ou qu’un obus tiré par un canon Caesar en rendant inutilisables des équipements, des matériels ou des infrastructures militaires ? Un virus aux effets systémiques, par la désorganisation massive qu’il provoquera, aboutira-t-il à la mort d’êtres humains, y compris des civils ? Comme le souligne la Revue stratégique de cyberdéfense publiée en février 2018 par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) : « Il est probable qu’une attaque informatique de cette nature [actes de blocage ou de sabotage des systèmes informatiques] aura, un jour, des conséquences létales. »
Les coopérations européennes en matière d’armement 4/4Publié le 12/05/2018
Une meilleure cohérence entre les commandes et les ressources budgétaires
Incapable d’assurer dans la durée la cohérence entre les ambitions capacitaires des lois de programmation militaire et la trajectoire du budget d’équipement des forces, l’État s’est trop souvent placé dans l’obligation de réaliser des économies budgétaires à court terme .
Les coopérations européennes en matière d’armement 3/4Publié le 11/05/2018
La Cour a examiné en 2017 six coopérations majeures, et notamment quatre programmes produisant des systèmes d’armes complets (avion A400M, hélicoptère TIGRE et NH90, frégate FREMM) . Les caractéristiques militaires sont parfois meilleures que les attentes 4, mais aussi parfois insuffisantes en raison des difficultés technologiques rencontrées par les industriels pour satisfaire les demandes 5 .
Les coopérations européennes en matière d’armement 1/4Publié le 09/05/2018
Alors que les dépenses militaires augmentent partout dans le monde sauf en Europe de l’Ouest, la Revue stratégique de défense et de sécurité nationale d’octobre 2017 promeut la coopération européenne en matière d’armement comme une clé de l’autonomie stratégique . Trois effets des coopérations internationales peuvent y contribuer :
. l’interopérabilité des armées nationales ;
. le partage des coûts de matériels onéreux et innovants ;
. le soutien à l’industrie européenne de défense.
Le soldat augmenté - Les cahiers de la revue défense nationalePublié le 08/05/2018
Les progrès scientifiques et techniques ainsi que la convergence actuelle des nanotechnologies, des biotechnologies, de l’informatique et des sciences de la cognition (NBIC) ouvrent des perspectives inédites de renforcement des capacités humaines, tant sur le plan physique qu’intellectuel. La société civile l’a bien compris, elle qui entrevoit les nouvelles perspectives que cette révolution peut entraîner pour l’humanité, lui permettant de devenir actrice de sa propre condition, et ainsi tenter de dépasser ses limites physiques et physiologiques.
Les armées des monarchies arabes du Golfe sont en pleine mutationPublié le 05/05/2018
Les armées des monarchies du Golfe n’ont historiquement joué qu’un rôle accessoire dans leur stratégie de sécurité nationale. Leur capacité de combat demeurant, en définitive, très limitée, la sécurité de ces États provenait davantage des politiques internationales fortement entretenues par d’importantes acquisitions d’armement.
137 Nuances de terrorismePublié le 10/04/2018
Cette étude, réalisée à partir de sources judiciaires originales, analyse les profils et les parcours de 137 individus condamnés en France dans des affaires de djihadisme. Il en ressort que ces individus se distinguent par un niveau d’éducation et une intégration professionnelle plus faibles, un degré de pauvreté plus important, un engagement dans la criminalité plus élevé et un rapport plus étroit au Maghreb et à l’Afrique subsaharienne que la moyenne de la population française.
Place du SNU dans l’éducation du citoyenPublié le 09/03/2018
S’interroger sur la portée du service national universel (SNU), c’est avant tout poser la question de sa finalité profonde et de l’adéquation de sa mise en œuvre à cette finalité : quelles sont les réponses qu’il devra apporter pour atteindre les objectifs que le politique lui fixera ?
Le service national universel, quelle volonté pour la France ?Publié le 08/03/2018
Le GDI (2S) Jean-Claude ALLARD estime quant à lui que le SNU est une mauvaise réponse aux maux de notre jeunesse. Embrassant largement les actions à mener,
pour lui « l’école est le combat premier ».
Une autre réponse, le service civil universelPublié le 07/03/2018
Au final, le SNU est-il la bonne réponse aux objectifs poursuivis ? Pas pour le général (2S) Hubert BODIN qui milite pour une forme de service civique renouvelé.